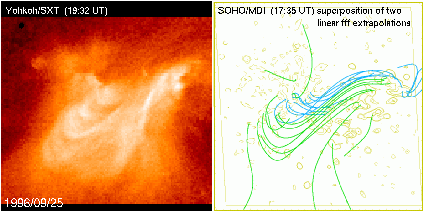
Aulanier G., Schmieder B., Démoulin P., van Driel-Gesztelyi L., DeForest C., 1998, ASP conf. series 155, 105
L'exemple presenté ci-dessous montre la comparaison des boucles coronales observées en rayons X par le satellite japonais Yohkoh/SXT (a gauche) avec les calculs théoriques (a droite) effectués à partir de magnétogrammes de SOHO/MDI. Cette étude a montré que le champ magnétique contient des courants électriques, et que leur amplitude croît avec le temps. Ceci indique que l'énergie magnétique de la région augmente, ce qui permet d'expliquer pourquoi cette région produit un grand nombre d'éjections de masse coronale vers le milieu interplanétaire.
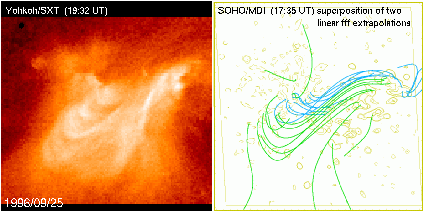
Aulanier G., Schmieder B., Démoulin P., van Driel-Gesztelyi L., DeForest C., 1998, ASP conf. series 155, 105
Par la même méthode d'investigation, l'exemple suivant a permis de montrer que les boucles de basse altitude sont traversées par des courant plus intense que les boucles a haute altitude. Cela a permis d'évaluer la quantité de courant présent dans un filament solaire observé sous ces boucles, et de contraindre les modèles théoriques décrivant ces objets.
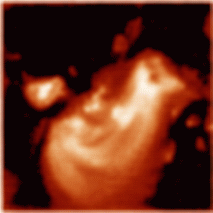
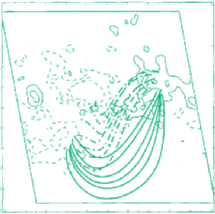
Schmieder B., Démoulin P., Aulanier G., Golub L., 1996, ApJ 467, 881
La reconstruction du champ B dans les régions actives a de nombreuses autres applications. L'exemple suivant montre l'application de ce type de calcul pour l'étude du chauffage coronal. Bien qu'il soit encore mal compris pourquoi la couronne solaire est à un température de 2 millions de degrés, il existe de nombreux modèles purement théoriques qui d'expliquent le chauffage coronal par la dissipation de l'énergie magnétique dans des nappes fines parcourues par des courants électriques intenses. Ces modèles peuvent être regroupés en deux grandes familles : les modèles ``directs'' (micro-éruptions, relaxation de Taylor, mouvements stochastiques, etc...) et ``indirects'' (ondes magnéto-acoustiques, surfaces résonantes, turbulence, etc...). Ces modèles dépendent différemment des paramètres physiques tels que la densité du plasma, la champ magnétique et la longueur des lignes de champ.
Grâce aux reconstructions théoriques, des lois d'échelle pour la variation du champ B le long des lignes de champ (voir la Figure 1) ont été calculées par la reconstruction d'un grand nombre de régions actives obsrervées en rayons X par Yohkoh/SXT (un exemple est présenté ci-dessous). Ces résultats ont été combinés avec les longueurs calculées pour les lignes de champ, et avec des résultats obtenus précedemment sur la distribution du plasma le long des boucles observées en rayons X. Cela a permis de tester les modèles théoriques de chauffage. Il a été déduit que les modèles ``directs'' (cas nos 1 à 14 en abscisse de la Figure 2) correspondaient en général mieux aux observations en rayons X que les modèles ``indirects'' (cas nos 15 à 21), hormis pour le cas de la turbulence MHD (cas no 22).
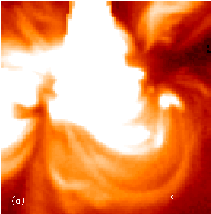
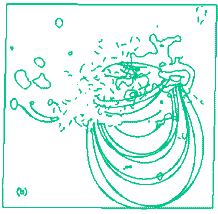
Figure 1: profils de la variation du champ B le long des lignes de champ :
Figure 2: tests sur les modèles
``directs'' (de 1 à 14) et ``indirects'' (de 15 à 22) :
Mandrini C.H.,
Démoulin P., Klimchuk J.A., 2000, ApJ 530, 999