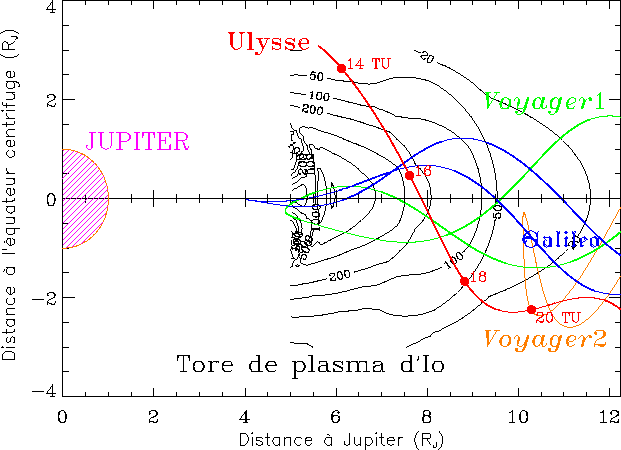Next: Le paysage radio vu
Up: Les visiteurs du tore
Previous: L'équateur centrifuge
Maintenant qu'on ne peut plus se perdre dans la magnétosphère de Jupiter,
on peut aussi comparer la trajectoire d'Ulysse [1992] à celles des trois
autres coupes in situ du tore dont nous disposons,
à savoir Voyager 1 et 2 [1979-80], et Galileo [1996].
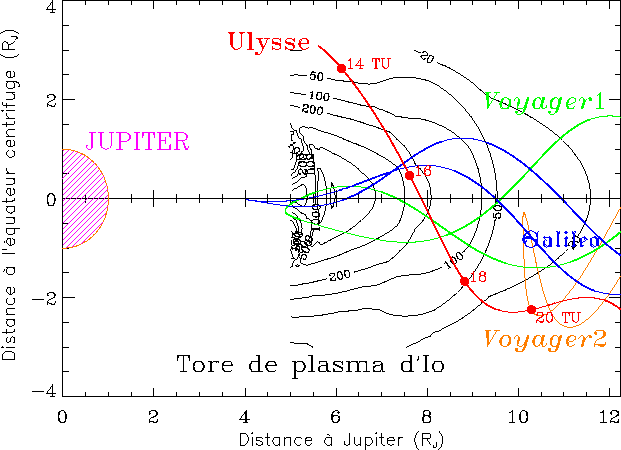
Figure i.2: Trajectoires, projetées dans un plan méridien du tore, des
quatre sondes qui ont traversé le tore ou sa proche banlieue : Voyager 1
(vert), Voyager 2 (jaune), Ulysse (rouge) et Galileo (bleu). Les temps (en
heures TU) indiqués par des points sont relatif à la traversée d'Ulysse (8
février 1992). Les isocontours sont ceux des densités électroniques calculées
avec le modèle de Bagenal [1994] (isotrope,modèle de champ  ,sans
lame de courant)
,sans
lame de courant)
On voit immédiatement
sur la figure i.2, l'avantage qu'on peut tirer des mesures faites
sur Ulysse, même s'il a fallu déployer de l'astuce pour exploiter
ces données :
Ulysse a en effet réalisé la seule coupe méridienne
du tore de plasma d'Io (dans une partie du tore relativement dense,
autour de
:
Ulysse a en effet réalisé la seule coupe méridienne
du tore de plasma d'Io (dans une partie du tore relativement dense,
autour de  ) et
par conséquent la seule susceptible de mesurer l'extension latitudinale
(ou confinement) du tore «en vraie grandeur». Les autre sondes (exceptée
Voyager 2 qui n'a pas, à proprement parler, exploré le tore mais plutôt
le feuillet de plasma magnétosphèrique au delà de
) et
par conséquent la seule susceptible de mesurer l'extension latitudinale
(ou confinement) du tore «en vraie grandeur». Les autre sondes (exceptée
Voyager 2 qui n'a pas, à proprement parler, exploré le tore mais plutôt
le feuillet de plasma magnétosphèrique au delà de  ) sont restées
proches de l'équateur centrifuge et n'ont fourni que des profils de variation
radiale des densités et températures. Par exemple, les isocontours indiqués
sur cette figure sont calculés à partir des mesures de Voyager 1 à
l'immersion
) sont restées
proches de l'équateur centrifuge et n'ont fourni que des profils de variation
radiale des densités et températures. Par exemple, les isocontours indiqués
sur cette figure sont calculés à partir des mesures de Voyager 1 à
l'immersion , extrapolées aux hautes latitudes en se fondant sur l'hypothèse
d'équilibre thermique du plasma (impliquant les températures de chaque espèce
constantes le long des lignes de champ) qui a été
infirmée par les mesures d'Ulysse, comme on le verra dans la deuxième partie
de la thèse. Ceci a notamment été possible parce qu'une bonne moitié
de la trajectoire d'Ulysse
(cf. les éphémérides des quatre
sondes données en annexe A.1) est grosso modo inscrite sur une coquille
magnétique de rayon dipolaire
, extrapolées aux hautes latitudes en se fondant sur l'hypothèse
d'équilibre thermique du plasma (impliquant les températures de chaque espèce
constantes le long des lignes de champ) qui a été
infirmée par les mesures d'Ulysse, comme on le verra dans la deuxième partie
de la thèse. Ceci a notamment été possible parce qu'une bonne moitié
de la trajectoire d'Ulysse
(cf. les éphémérides des quatre
sondes données en annexe A.1) est grosso modo inscrite sur une coquille
magnétique de rayon dipolaire  , et qu'on aurait donc dû y
mesurer des températures constantes.
, et qu'on aurait donc dû y
mesurer des températures constantes.
C'est en résumé le caractère exceptionnel (et qui ne se représentera
pas de sitôt) de cette trajectoire méridienne d'Ulysse dans le tore, balayant
au total
 du nord au sud du tore, c'est-à-dire plusieurs échelles de
hauteur caractéristique du
confinement (de l'ordre du rayon jovien),
qui a justifié les efforts faits sur les spectres radio d'Ulysse, et que nous
allons exposer dans les chapitres suivants.
du nord au sud du tore, c'est-à-dire plusieurs échelles de
hauteur caractéristique du
confinement (de l'ordre du rayon jovien),
qui a justifié les efforts faits sur les spectres radio d'Ulysse, et que nous
allons exposer dans les chapitres suivants.




Next: Le paysage radio vu
Up: Les visiteurs du tore
Previous: L'équateur centrifuge
Michel Moncuquet
Tue Jan 13 19:37:26 MET 1998