- ...fois
- Pioneer 10 est effectivement passé
dans le tore d'Io en décembre 1973, mais ses observations n'ont pu être
véritablement interprétées comme une détection de celui-ci qu'après Voyager 1
[Intriligator and Miller, 1981]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...sondes
- Voyager 1 et 2 [1979-80], Ulysse [1992] et
Galileo [1996]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...reprises
- Voyager 1 et 2 [1979-80], Ulysse [1992] et
Galileo [1996]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...exceptionnelle
- précisément parce qu'il fallait sortir Ulysse du plan de l'Écliptique, en
utilisant la gravité de Jupiter
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...façon
- cela produit simplement une translation en
énergie, qui multiplie la maxwellienne par une constante, donc ne modifie pas
sa «température»
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...ions
- principalement de l'oxygène et
du soufre, dans des proportions mystérieuses et variables [Strobel, 1989]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...pick-up
- J'en profite pour prier le
lecteur de m'excuser des termes d'anglais pas ou mal traduits qui peuvent
traîner ça et là dans cette thèse. L'usage du français en science disparaît
hélas tranquillement et les mots pour désigner certains objets ou concepts en
physique des plasmas, bien qu'ils existent souvent ou qu'ils puissent être
facile à former, sont rarement utilisés ou reconnus par les français eux-mêmes.
Comment traduisez-vous par exemple pick-up, current sheet, plasmasheet
ou pitch-angle ? réponse (ici): assimilation, lame de courant,
feuillet de plasma, et, pour le dernier, je donne ma langue au chat
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...soupçonnée
- je dis seulement «soupçonnée»
parce qu'on ne dispose malheureusement pas de mesures fiables des températures
parallèles des ions
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...magnétique
- tous nos calculs ont été
faits en utilisant les modèles du GSFC [Connerney, 1992]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...trois
- Nous ne tenterons à dire vrai dans cette thèse
aucune interprétation des résultats de Galileo, trop récents pour qu'on aît pu
les incorporer sérieusement à ce travail; mais c'est bien sûr en cours
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...sondes
- Voyager 1 et 2 [1979-80], Ulysse [1992] et
Galileo [1996]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...élevées
- néanmoins seulement 2 fois plus élevées que «prévu» par
[Bagenal, 1994] dans la partie externe du tore, i.e. la même différence qu'avec
Ulysse, cette augmentation globale de la densité du tore pouvant être mise au
compte d'une activité volcanique d'Io plus intense précédemment au passage
d'Ulysse ou de Galileo que lors des passages de Voyager 1 et 2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...thèse
- Nous ne tenterons à dire vrai dans cette thèse
aucune interprétation des résultats de Galileo, trop récents pour qu'on aît pu
les incorporer sérieusement à ce travail; mais c'est bien sûr en cours
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...jovitropes
- ceux qui
aiment tourner leurs radio-télescopes vers Jupiter
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...densité
- correspondant aux mesures acquises dans
[Moncuquet et al., 1997],cf. première partie de la thèse
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...éloignées
- ce qui est
toujours le cas de Voyager 2 mais concernera surtout, pour Voyager 1, les
distances radiales
 , et les effets induits sur les températures
équatoriales des ions déjà discutés en section vi.1 de ce chapitre vi
, et les effets induits sur les températures
équatoriales des ions déjà discutés en section vi.1 de ce chapitre vi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...fort
- l'intensité, à l'équateur
magnétique et à la surface de Jupiter, est
 T, à comparer
à
T, à comparer
à  T pour la Terre et
T pour la Terre et  T pour Saturne
T pour Saturne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...dipolaire
- en première approximation, il s'agit d'un
dipôle centré dont le moment magnétique est incliné d'environ 9.6° sur
l'axe de rotation jovien
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...adiabatique
- la variation
 de B
dans l'espace (dans le temps) sur une distance égale à
de B
dans l'espace (dans le temps) sur une distance égale à  (sur une période égale à
(sur une période égale à  ) est telle que
) est telle que  [Delcroix et Bers, 1994, p.102,,]
[Delcroix et Bers, 1994, p.102,,]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...magnétique
- appelé aussi pour cette raison
premier invariant adiabatique
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...cyclotron
- du fait de sa superposition au mouvement cyclotron, il
s'agit d'une dérive du centre instantané de rotation de la particule, appelé
centre guide
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...adiabatique
- la variation
 de B
dans l'espace (dans le temps) sur une distance égale à
de B
dans l'espace (dans le temps) sur une distance égale à  (sur une période égale à
(sur une période égale à  ) est telle que
) est telle que  [Delcroix et Bers, 1994, p.102,,]
[Delcroix et Bers, 1994, p.102,,]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...planète
- particulièrement rapide pour Jupiter : un tour en 9h50min
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...près
- nulle
dans le cas d'un dipôle de moment magnétique non incliné sur l'axe de
rotation de la planète
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...planétaire
- Dans la réalité, l'hypothèse du champ gelé
n'est qu'imparfaitement vérifiée et la vitesse de rotation du plasma n'est pas
la corotation angulaire rigide avec la planète : on parle alors de
sous-rotation (corotation lag) du plasma [Hill, 1980, i.e.,]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...particules
- c'est-à-dire les particules de plus basse énergie (donc de petit
 ) de la
distribution, qu'on appelle souvent aussi «les froids» ou encore le
coeur (approximation curieuse de l'anglais core), le reste formant «les
chauds», ou le halo.
) de la
distribution, qu'on appelle souvent aussi «les froids» ou encore le
coeur (approximation curieuse de l'anglais core), le reste formant «les
chauds», ou le halo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...surface
- Notons que cette surface n'est un plan que dans le cas d'un
dipôle magnétique centré (incliné ou non)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...données
- du fait qu'Ulysse est
équipée pour étudier le vent solaire, pas la magnétosphère jovienne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...l'immersion
- en l'occurrence la demi-trajectoire la plus proche de
l'équateur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...situ
- J'exclus ici l'expérience
d'occultation radio [Bird et al., 1993]
dont le principe repose sur l'atténuation du signal de communication radio
entre Ulysse et la Terre, dont je ne conteste pas la
qualité mais dont je soutiens qu'elle n'est pas stricto-sensu une mesure
de la densité dans le tore: cette expérience mesure en fait la densité intégrée
sur la ligne de visée Ulysse-Terre, ce qui suppose à la fois de retrancher un
modèle d'Ionosphère terrestre (incertitudes comprises) et surtout d'utiliser
un modèle préalable d'équilibre du tore (avec notamment un positionnement de
l'équateur centrifuge lié lui-même à un modèle de champ magnétique et de
corotation). Cette expérience prend tout son intérêt si on peut comparer ses
résultats à des mesures in situ, auquel cas on valide ou non les modèles
utilisés pour dépouiller, mais elle ne permet pas de fournir une mesure
indépendante d'un modèle de tore
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...Z)
-
qui ne présente pas d'intérêt pour notre étude, sinon que son signal est
(malheureusement) quelquefois sommé à celui de l'antenne S,
voir aussi note 18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...DESPA
- Département de Recherche
Spatiale, où je travaille
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...,]
- des émissions hectométriques HOM, i.e. autour de 300 kHz et plus, et
des émissions kilométriques
nkOM et bKOM (pour narrow et broadband),
grosso modo centrées sur 100 kHz, avec des sursauts (type III jovien)
descendant jusqu'à
 10 kHz
10 kHz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...variées
- par exemple : modes VLF, siffleurs (ou whistlers),
modes cyclotron,
on en trouvera une zoologie assez complète dans [Farrell et al., 1993]. On peut aussi
comparer ce spectre de la magnétosphère de Jupiter au spectrogramme qu'on
prévoit d'observer dans la magnétosphère de Saturne avec Cassini (annexe A.4):
à part les émissions radio propres à Saturne, on s'attend aux mêmes émissions
locales
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...heures
- Cette durée, arbitrairement fixée,
correspond en fait à une période où les antennes S et Z étaient séparées
(zone non «voilée» sur la figure i.3, les zones
entre 8h et 14h et entre 18h et 21h10 étant «voilées» par le bruit
de l'antenne Z sommée à S)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...physiques
-
une intéressante analyse des spectres radio d'Ulysse a aussi
été faite pour la période allant de 8h30 à 14h [Desch, Farrell and Kaiser, 1994],
permettant de dériver des densités électroniques à des latitudes très élevées
(
 au dessus de l'équateur centrifuge). Malheureusement, ces densités
sont peu fiables, car leur détermination est liée à la détection de la
coupure (cutoff) d'ondes basses fréquences à la fréquence plasma, mais
cette coupure peut survenir à cause d'un plasma rencontré par les ondes
à un autre point de l'espace que celui où se trouve Ulysse.
au dessus de l'équateur centrifuge). Malheureusement, ces densités
sont peu fiables, car leur détermination est liée à la détection de la
coupure (cutoff) d'ondes basses fréquences à la fréquence plasma, mais
cette coupure peut survenir à cause d'un plasma rencontré par les ondes
à un autre point de l'espace que celui où se trouve Ulysse.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...favorables
- configurations plaisamment décrites
dans [Meyer-Vernet and Perche, 1989], qui est LE papier sur le sujet.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...plasma
- on montre aussi
dans ce cas que la température des froids peut être estimée
en utilisant l'expression du bruit thermique sans champ magnétique
[Meyer-Vernet, Hoang and Moncuquet, 1993, voir
Éq.(27),]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...l'instrument
-
ce qui n'aurait pas été le cas avec les instruments radio embarqués sur
Voyager ou Galileo (PRA et PWS) dont la sensibilité, indiquée sur la
fig.i.5, eut été insuffisante pour poursuivre l'étude présentée ici
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...gyroharmoniques
- ce qui est un
moyen, on y reviendra au chapitre iii (fig. iii.1),
de déterminer la magnitude du champ
avec une bonne précision, de l'ordre de 1%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...observée
- environ 2% de chauds à 1keV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...expérimentalement
- pour la première
fois dans un plasma naturel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...calibration
- C'est souvent le problème des instruments envoyés
dans l'espace interplanétaire et seulement conçus pour détecter les
émissions radio les plus puissantes : dotés
d'un récepteur sans grande résolution spectrale et peu sensible, recueillant un
signal pas ou mal calibré, il n'émerge que des «pics» (comme d'ailleurs
pour Ulysse dans la bande HF), qui sont alors dûment répertoriés et pour
la plupart interprétés sans vérification quantitative sur l'amplitude
par des instabilités de plasma.
Par exemple, les augmentations de puissance entre les gyroharmoniques que nous
avons étudiées sur Ulysse, si elles n'avaient émergé d'aucun substrat
physiquement quantifiable (i.e. le bruit thermique), auraient été néanmoins
reconnues comme les sempiternelles "émissions
 " et attribuées à des
instabilités. Comme on n'en tire pas grand-chose sur la physique des milieux
visités, si ce n'est qu'ils sont décidément très instables,
on renvoie généralement le même instrument dans l'espace, qui confirmera...
" et attribuées à des
instabilités. Comme on n'en tire pas grand-chose sur la physique des milieux
visités, si ce n'est qu'ils sont décidément très instables,
on renvoie généralement le même instrument dans l'espace, qui confirmera...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...mètres
- ce qui, coup de veine, est aussi l'ordre de
grandeur de la longueur de Debye typique des électrons du vent solaire, pour la
mesure desquels l'antenne d'Ulysse a été conçue!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...une
- exemple de raison pour laquelle les radio-astronomes
aiment moins en général les satellites stabilisés 3-axes
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...faible
- Les modes de Bernstein sont des
solutions de l'équation de
dispersion des ondes dans l'approximation électrostatique
(
 ), qui n'est valide que dans
un plasma à faible
), qui n'est valide que dans
un plasma à faible 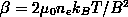 . Dans la partie du tore d'Io explorée
par Ulysse, on a
. Dans la partie du tore d'Io explorée
par Ulysse, on a 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...plasma
- mais on peut constater
qu'elles sont sporadiques sur les
spectres d'Ulysse/tore ou de Wind/Plasmasphère
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...planétaires
- Citons l'AKR pour la Terre et
surtout, pour Saturne, le SKR qui peut, dans la
magnétosphère interne (
 ), s'approcher de la gyrofréquence des
électrons
), s'approcher de la gyrofréquence des
électrons
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...poursuivre
- Ces développements seront aussi nécessaires à
l'analyse détaillée des données
de deux sondes radio qui traverserons la Plasmasphère dans les prochaines
années : une sonde d'exploration de la Magnétosphère de la Terre «IMAGE»
et, s'il est sélectionné, le petit satellite d'observation radio «
 -ORAJES», dont on dit aussi un mot en annexe A.3
-ORAJES», dont on dit aussi un mot en annexe A.3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...HFR
- notamment les trois premières bandes, couvrant 3.5 à 318 kHz,
pourront être exploitées pour l'analyse du bruit thermique.
Les récepteurs ont été construits au DESPA, et pour ces bandes, sont
de technologie comparable à ceux de TNR sur Wind
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...[Bagenal, 1994]]
- résumons la méthode utilisée pour le dernier cité :
on écrit l'équation du
mouvement à l'équilibre hydrostatique dans la direction parallèle à
 pour chaque espèce; on en déduit ensuite l'équation de la pression le long
des lignes de champ et,
supposant la température constante, on en déduit le profil de densité de
l'espèce de
particules considérée [Mei, Thorne and Bagenal, 1995, par ex.,]
pour chaque espèce; on en déduit ensuite l'équation de la pression le long
des lignes de champ et,
supposant la température constante, on en déduit le profil de densité de
l'espèce de
particules considérée [Mei, Thorne and Bagenal, 1995, par ex.,]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...centrifuge
- la latitude centrifuge est en
effet ici un bon indicateur du déplacement d'Ulysse parallèlement à
 :
en regardant les éphémérides d'Ulysse (présentés en annexe A.1), on peut
remarquer qu'Ulysse reste (entre 15° nord et 7° sud) pratiquement
sur une même coquille magnétique, autrement dit que son rayon dipolaire
équatorial L (le pied à l'équateur magnétique de la ligne de champ passant
par Ulysse) reste quasiment constant à
:
en regardant les éphémérides d'Ulysse (présentés en annexe A.1), on peut
remarquer qu'Ulysse reste (entre 15° nord et 7° sud) pratiquement
sur une même coquille magnétique, autrement dit que son rayon dipolaire
équatorial L (le pied à l'équateur magnétique de la ligne de champ passant
par Ulysse) reste quasiment constant à 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...magnétique
- la latitude centrifuge est en
effet ici un bon indicateur du déplacement d'Ulysse parallèlement à
 :
en regardant les éphémérides d'Ulysse (présentés en annexe A.1), on peut
remarquer qu'Ulysse reste (entre 15° nord et 7° sud) pratiquement
sur une même coquille magnétique, autrement dit que son rayon dipolaire
équatorial L (le pied à l'équateur magnétique de la ligne de champ passant
par Ulysse) reste quasiment constant à
:
en regardant les éphémérides d'Ulysse (présentés en annexe A.1), on peut
remarquer qu'Ulysse reste (entre 15° nord et 7° sud) pratiquement
sur une même coquille magnétique, autrement dit que son rayon dipolaire
équatorial L (le pied à l'équateur magnétique de la ligne de champ passant
par Ulysse) reste quasiment constant à 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...plasma
- dont la structure bien visible sur la figure iv.1 entre 0
et -5° pourrait être un exemple
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...indice
-
 correspond à
l'hypothèse d'équilibre diffusif isotherme, et, pour mémoire,
correspond à
l'hypothèse d'équilibre diffusif isotherme, et, pour mémoire,  correspond à une variation adiabatique à 3 degrés de liberté
qu'on ne s'attend de toutes
façons pas à trouver dans la direction de
correspond à une variation adiabatique à 3 degrés de liberté
qu'on ne s'attend de toutes
façons pas à trouver dans la direction de  où
où 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...mesure
- ce qu'on doit assurément faire
[Descartes, 1637]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...perpendiculaire
- puisqu'elle est obtenue à partir des courbes de
dispersion des modes de Bernstein [Moncuquet, Meyer-Vernet and Hoang, 1995, cf ,] qui
permet la détermination du rayon de Larmor moyen, lequel ne dépend évidemment
que de la distribution des vitesses perpendiculaires à

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...«mesuré»
- je
mets des guillemets parce que la mesure in situ des températures
parallèles
des ions dans le tore d'Io est quasi-inexistante. Il n'y a que des dérivations très
indirectes et peu fiables de l'anisotropie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...établir
- Ce calcul est mené dans les deux articles cités et n'est pas
davantage explicité ici car il est un cas particulier de celui
développé section v.2
pour des distributions d'énergies bi-kappa anisotropes, lorsqu'on se
restreint à des bi-maxwelliennes (i.e.
 ).
Il découle essentiellement de la conservation
de
).
Il découle essentiellement de la conservation
de 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...champ
- La variation de la température perpendiculaire le long de la
ligne de champ n'est que la traduction d'un point de vue macroscopique de
l'apparition, pour une particule qui voit le champ croître, d'une force miroir
magnétique la ramenant vers l'équateur magnétique (point de vue microscopique),
phénomène déjà évoqué pour la définition de l'équateur magnétique i.1.1. Le
calcul de cet effet est, des deux points de vue macroscopique ou microscopique,
déduit de la conservation du moment magnétique

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...tore
- ce qu'on doit assurément faire
[Descartes, 1637]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...latitude)
- notons que, pour la
même raison, cette variation de la température perpendiculaire est incompatible
avec un modèle standard CGL fluide d'un plasma sans collision
[Chew, Goldberger and Low, 1956], à supposer qu'un tel modèle soit applicable ici, car
la conservation du premier invariant adiabatique, prévue par CGL,
implique de même

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...rappel
- déjà évoquée pour
définir l'équateur centrifuge au chapitre i, section i.1.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...obtient
- On suppose que l'abscisse s est
accessible dans l'espace de phase (ce qui est le cas si le potentiel
reste attractif et monotone dans le domaine considéré).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...[Sittler and Strobel, 1987],
- Une autre possibilité intéressante serait de
reprendre les distributions mesurées par Voyager 1 et de les ajuster par des
fonctions kappa mais les mesures des distributions d'électrons sont assez
imprécises sur Voyager 1 à cause du problème des photo-électrons et du
potentiel flottant mal estimé. Cette perspective est probablement plus
envisageable concernant les distributions de vitesses des ions, quoique dans ce
cas la difficulté est surtout de séparer les différentes espèces
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...4)
- cette très faible variation est prévisible a
priori puisque qu'on sait que
 est proche de
est proche de  , qui est
indépendante par hypothèse de la latitude (coeur maxwellien). rappelons aussi
que la variation de la température T serait celle obtenue par un instrument
sensible à l'énergie moyenne de toutes les particules (i.e supposant toujours
le plasma à l'équilibre thermique). Si on dispose d'un instrument de mesure qui
discrimine à chaque mesure les températures
, qui est
indépendante par hypothèse de la latitude (coeur maxwellien). rappelons aussi
que la variation de la température T serait celle obtenue par un instrument
sensible à l'énergie moyenne de toutes les particules (i.e supposant toujours
le plasma à l'équilibre thermique). Si on dispose d'un instrument de mesure qui
discrimine à chaque mesure les températures  et
et  d'un plasma modélisé
par une core+halo (comme sur Voyager 1), cet instrument ne peut, par
hypothèse, qu'obtenir
d'un plasma modélisé
par une core+halo (comme sur Voyager 1), cet instrument ne peut, par
hypothèse, qu'obtenir  et
et  constantes le long des lignes de champ.
constantes le long des lignes de champ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...centrifuge
- il a même été dit lors d'une
conférence de presse qui a suivi la rencontre que le tore d'Io n'avait
pratiquement pas été mesuré par Ulysse (sic) et que, de toutes façons, le peu
qu'on en avait vu n'avait rien de commun avec celui exploré par Voyager 1
(re-sic): l'objectif de cette thèse est de prouver
le contraire de ces affirmations hâtives.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...corrects
- quant au modèle de
[Divine and Garrett, 1983], il ne prédit correctement ni l'un ni l'autre;
cela a fait dire à l'époque de la rencontre
[Stone et al., 1992b] que le modèle de Bagenal prédisait mieux ces mesures
(aux distances
 ) que celui de Divine et Garrett, mais on voit que c'est
assez fortuit quand on considère les mesures dans leur ensemble.
) que celui de Divine et Garrett, mais on voit que c'est
assez fortuit quand on considère les mesures dans leur ensemble.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...élevées.
- On verra cependant par la suite que,
comme le suggérait [Bagenal, 1994] s'agissant de l'interprétation des observations
d'Ulysse, une anisotropie (forte) des particules thermiques (le coeur des
distributions) permettrait de confiner suffisamment le tore, i.e. comme l'a vu
Ulysse, tout en conservant des distributions maxwelliennes et le profil radial
à l'équateur de Voyager 1. Il n'en reste pas moins qu'un tel modèle anisotrope
mais maxwellien reste incapable d'expliquer la variation latitudinale des
températures (il prévoit même, comme on l'a vu en iv.1 ou
figure 1.a de [Huang and Birmingham, 1992], une
diminution des températures avec la latitude).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...centrifuge
- plus rigoureusement
dit , la distance de Voyager à l'équateur centrifuge passe pratiquement de 0 à
1.5
 lorsque Voyager 1 s'éloigne de 7 à 10
lorsque Voyager 1 s'éloigne de 7 à 10  du centre de Jupiter
du centre de Jupiter
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...qualitatifs
- au sens où le qualitatif est du pauvre quantitatif
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...DPS
- Division for Planetary Sciences
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...précisément
- et même ajouter le potentiel gravitationnel bien
qu'il soit, pour les distances à Jupiter qui nous occupent, négligeable
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...parallèles
- [Herbert and Sandel, 1995] ont très
indirectement déduit ces températures parallèles des distributions de densités
déduites des spectres UV de Voyager 1 (expérience UVS); plus précisément,
puisqu'ils déduisent ces températures des échelles de hauteur
supposées gaussiennes dans
les densités (intégrées sur une ligne de visée) obtenues par UVS (en première
approximation
 ), cela signifie qu'ils supposent
l'équilibre thermique le long des lignes de champ (
), cela signifie qu'ils supposent
l'équilibre thermique le long des lignes de champ (  constante).
Autrement dit, dans l'interprétation de [Herbert and Sandel, 1995], le plus fort confinement
observé (sur UVS) des particules par rapport à ce qu'il devrait être
en supposant chaque espèce à l'équilibre thermique,
est entièrement mis «sur le dos» d'une variation de la
température parallèle des ions à l'équateur. On reviendra sur cette
interprétation au chapitre suivant
constante).
Autrement dit, dans l'interprétation de [Herbert and Sandel, 1995], le plus fort confinement
observé (sur UVS) des particules par rapport à ce qu'il devrait être
en supposant chaque espèce à l'équilibre thermique,
est entièrement mis «sur le dos» d'une variation de la
température parallèle des ions à l'équateur. On reviendra sur cette
interprétation au chapitre suivant
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...ions
- Pour les électrons , l'isotropisation par collision est
assez rapide, de l'ordre de l'heure, tandis qu'elle est plutôt de l'ordre du
mois pour les ions [Book, 1986, voir p.33 du ,])
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...d'Io
- Dans son modèle à distributions coeur+halo, [Bagenal, 1994] ne
suppose des anisotropies que pour les halos des distributions, considérant les
coeurs isotropes. Mais elle suggère néanmoins qu'une anisotropie des particules
thermiques pourrait peut-être expliquer le confinement vu par Ulysse, ce qui
était bien vu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...grands
- Pour les électrons , l'isotropisation par collision est
assez rapide, de l'ordre de l'heure, tandis qu'elle est plutôt de l'ordre du
mois pour les ions [Book, 1986, voir p.33 du ,])
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...qualitatifs
- au sens où le qualitatif est du pauvre
quantitatif
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...point
- supposé accessible dans
l'espace de phase du mouvement des particules
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...l'immersion
- notons qu'on peut facilement dans notre code
de calcul substituer d'autres valeurs de références à celles-ci, par exemple
les mesures obtenues récemment par Galileo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...possible
- voir à cet égard la figure 92 de
[Strobel, 1989] qui
donne l'évolution de la composition en fonction des publications scientifiques
et qui pourrait être prolongée jusqu'à nos jours
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...radiale
- le code permet, on y reviendra en
section vi.2, des kappa et
anisotropies pour chaque espèce de particule et même variables avec la distance
à Jupiter, mais en l'absence de valeurs expérimentales de ces paramètres pour
les ions, on se bornera ici à montrer cet exemple.
En revanche, on a pris pour les
électrons
 d'après nos mesures d'Ulysse et
d'après nos mesures d'Ulysse et  d'après
[Sittler and Strobel, 1987]
d'après
[Sittler and Strobel, 1987]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...différents
- notons d'emblée que ces différences ne proviennent pas du modèle de
champ magnétique
utilisé, puisqu'on a calculé les profils de la figure vi.2 en
utilisant
 + feuillet de plasma de [Connerney, 1992], c'est-à-dire
le même modèle que celui utilisé par [Bagenal, 1994] pour extrapoler les
données de Voyager 1 à l'équateur centrifuge. J'en profite aussi
pour signaler que la densité des protons (en vert
sur les figures) a été divisée par 2 en entrée du code
pour tenir compte d'un résultat récent de [Crary et al., 1996], mais cela
n'a que très peu d'incidence sur les autres profils de densité
+ feuillet de plasma de [Connerney, 1992], c'est-à-dire
le même modèle que celui utilisé par [Bagenal, 1994] pour extrapoler les
données de Voyager 1 à l'équateur centrifuge. J'en profite aussi
pour signaler que la densité des protons (en vert
sur les figures) a été divisée par 2 en entrée du code
pour tenir compte d'un résultat récent de [Crary et al., 1996], mais cela
n'a que très peu d'incidence sur les autres profils de densité
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...Europe
- une partie du peuplement du tore vers
 proviendrait de la
surface et/ou de l'atmosphère ténue d'Europe (c'est un euphémisme: la pression
vaut
proviendrait de la
surface et/ou de l'atmosphère ténue d'Europe (c'est un euphémisme: la pression
vaut  fois celle de la Terre! [Hall et al., 1995]), dû
notamment au criblage(sputtering) de cette surface par les particules du
tore d'Io [Schreier et al., 1993, par ex.,]
fois celle de la Terre! [Hall et al., 1995]), dû
notamment au criblage(sputtering) de cette surface par les particules du
tore d'Io [Schreier et al., 1993, par ex.,]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...Ulysse
- et même renforcée, puisque la densité
électronique prédite
est plus faible que la densité observée réellement par Ulysse (voir figure
vi.4). Notons qu'à sa traversée de l'orbite d'Europe, Ulysse
se trouvait à
 de l'équateur centrifuge.
de l'équateur centrifuge.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...espèces
- notons que la densité et la température des protons, représentées en
vert sur les figures, sont fausses après 7.5
 quand on les calcule avec
notre modèle. On ne peut en effet numériquement «contrôler» ces paramètres
avec notre code après 7.5
quand on les calcule avec
notre modèle. On ne peut en effet numériquement «contrôler» ces paramètres
avec notre code après 7.5  , à cause à la fois de la trop faible densité
des protons par rapport à la charge totale et leurs trop faibles énergies par
rapport aux ions O et S respectivement 16 et 32 fois plus massifs. On a donc
conservé pour les protons une température identique à celle de [Bagenal, 1994]
et une densité divisée par 2 (voir note 5).
, à cause à la fois de la trop faible densité
des protons par rapport à la charge totale et leurs trop faibles énergies par
rapport aux ions O et S respectivement 16 et 32 fois plus massifs. On a donc
conservé pour les protons une température identique à celle de [Bagenal, 1994]
et une densité divisée par 2 (voir note 5).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...

- au delà de
 il est
délicat de tirer des conclusions sur cette variation des températures, car
à cette distance, un certain nombre d'effets supplémentaires
à la diffusion radiale du plasma depuis l'orbite d'Io
(par exemple l'apport d'Europe ou le feuillet de plasma
alimenté par des processus très différents) peuvent jouer un rôle
non négligeable dans la structure du plasma
il est
délicat de tirer des conclusions sur cette variation des températures, car
à cette distance, un certain nombre d'effets supplémentaires
à la diffusion radiale du plasma depuis l'orbite d'Io
(par exemple l'apport d'Europe ou le feuillet de plasma
alimenté par des processus très différents) peuvent jouer un rôle
non négligeable dans la structure du plasma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...joviens.
- il est bon de
préciser pourquoi le résultat obtenu par
[Herbert and Sandel, 1995], qui suppose a priori l'équilibre thermique local
du plasma, est compatible avec le nôtre. Ces auteurs,
ayant observé des distributions de densités plus confinées autour de
l'équateur en s'éloignant de Jupiter, et donc des échelles de hauteurs
gaussiennes moindres, ont
conclu à une baisse des températures parallèles. Si l'on suppose maintenant,
comme nous le faisons ici,
que ce plus grand confinement observé est en fait dû à la présence de
distributions d'énergies des ions non-thermiques (bi-kappa),
on ne peut plus tenir le
raisonnement précédent, mais on «récupère» naturellement
la baisse des températures
du fait de l'augmentation des latitudes de Voyager 1,
via la loi polytrope à indice ;SPMlt; 1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...moment
- c'est-à-dire jusqu'à l'ajustement de distributions
kappa aux distributions expérimentales fournies par les
analyseurs de particules
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...pas.
- Disons seulement sans le montrer
qu'en essayant d'ajuster des kappa ou anisotropies
pour obtenir les profils de densité acquis par Ulysse,
il semble que le kappa va croissant avec la distance jovicentrique ou
que l'anisotropie va décroissant, sans qu'on puisse choisir
entre ces deux tendances. Ce résultat ne semble pas surprenant puisque ces deux
tendances signifient simplement que l'on se rapproche de l'équilibre
thermique isotrope en s'éloignant radialement
de l'orbite d'Io; c'est effectivement
ce qui est attendu naïvement en supposant que plus on s'éloigne (en espace et
en temps) du lieu d'assimilation des neutres
(qu'on peut considérer comme le lieu
de plus grand déséquilibre thermodynamique), plus les
processus de thermalisation et d'isotropisation entrent en jeu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...effarante
-
en tous cas difficile à justifier théoriquement et provoquant les
effets fâcheux déjà expliqués sur les températures équatoriales
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...d'Europe
- une partie du peuplement du tore vers
 proviendrait de la
surface et/ou de l'atmosphère ténue d'Europe (c'est un euphémisme: la pression
vaut
proviendrait de la
surface et/ou de l'atmosphère ténue d'Europe (c'est un euphémisme: la pression
vaut  fois celle de la Terre! [Hall et al., 1995]), dû
notamment au criblage(sputtering) de cette surface par les particules du
tore d'Io [Schreier et al., 1993, par ex.,]
fois celle de la Terre! [Hall et al., 1995]), dû
notamment au criblage(sputtering) de cette surface par les particules du
tore d'Io [Schreier et al., 1993, par ex.,]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...commode
- il s'agit bien d'un outil
commode, qui permet de décrire la coexistence d'une population de particules à
l'équilibre (quasi-maxwellienne) et d'une population dont les distributions
varient en loi de puissance des énergies, comme on l'a souvent observé dans les
plasmas naturels; mais rappelons qu'on peut aussi introduire ce «
déséquilibre» en partant d'un modèle fluide auquel on adjoint une loi
polytrope à indice ;SPMlt;1 [Meyer-Vernet, Moncuquet and Hoang, 1995]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...admis
- et qui, introduit seul
(i.e. en utilisant une distribution bi-maxwellienne), prévoit une
diminution de la température avec la latitude, c'est-à-dire le
contraire de ce qu'Ulysse a observé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...sondes
- notons qu'il existe une possibilité (en cours
d'exploitation)
d'utiliser des données de polarité de sources radio joviennes
(polarisées rectilignement)
observées par Voyager durant les mois qui ont précédé et suivi sa rencontre
avec Jupiter, et
de remonter ainsi à la densité intégrée sur la ligne de visée de ces sources
grâce à l'effet «rotation Faraday» [A. Lecacheux,
communication privée]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...sérendipiteux,
- je tente ce terme cuistre de franglais, qui veut
simplement exprimer la joie de trouver ce qu'on ne cherchait pas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...conditions
-
essentiellement, l'antenne doit être plusieurs fois plus longue que la
longueur de Debye pour observer les ondes de Langmuir.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...magnétosphère
- supposé accessible
dans l'espace de phase du mouvement des particules du plasma, et repéré
par son abscisse curviligne s à partir de l'équateur centrifuge et le
long de la ligne de champ à laquelle appartient P.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.