Retour sur la magnitude du champ
Avant de tirer le bilan détaillé des mesures dues à notre «spectroscopie
du bruit en mode de Bernstein», et qui pour
l'essentiel sont celles publiées dans les deux articles du chapitre
précédent, revenons brièvement sur la possibilité
d'utiliser l'antenne comme un magnétomètre. Cette faculté tient au fait
qu'en première analyse [Meyer-Vernet, Hoang and Moncuquet, 1993, cf. ici i.3 ou dans,]
le signal doit atteindre des minima relatifs à chaque harmonique de la
gyrofréquence, à cause de l'amortissement de tous les modes de Bernstein
(contrôlés par les chauds) justement à ces fréquences.
Néanmoins, et on peut le
constater sur les spectres des figures 2
de [Moncuquet et al., 1997] (figures 2a et 2b ), les minima ne sont
pas forcément atteints exactement aux gyroharmoniques. Cela peut
s'expliquer notamment par
l'existence des bandes interdites à la propagation
des modes de Bernstein dans certaines bandes (ce qui
décalera le minimum systématiquement en amont de la gyroharmonique),
et par l'existence de modes décalés Doppler (par la vitesse
de corotation) autour des gyroharmoniques, qui pourront augmenter la
puissance spectrale à la gyroharmonique (décalant le minimum de bruit
sans qu'on puisse à priori préciser dans quel sens).
Cependant, si on dispose de plusieurs gyroharmoniques, comme c'est
le cas sur nos données à partie de 18-19 T.U., on peut espérer réduire
ces écarts à la gyroharmonique exacte (s'ils sont non systématiques).
On montre sur la figure suivante iii.1 les
fréquences des minima (points)
relatifs (c'est-à-dire intercalés entre deux maxima relatifs) mesurés sur
Ulysse. On a ensuite déduit de ces points
la valeur de la fréquence gyromagnétique
![]() pour chaque spectre (par une moyenne harmonique de 1 à 8 points)
et on a tracé
cette valeur en fonction du temps (trait plein du bas), ainsi que ses
multiples entiers (autres traits pleins). Le résultat est très proche (1%)
de la magnitude fournie par le magnétomètre d'Ulysse (trait hachuré),
et même d'autant plus proche que le nombres de minima disponibles
est grand, ce qui montre que les écarts ne se font pas systématiquement
en amont ou en aval de l'harmonique considérée.
Par contre, lorsqu'on ne dispose que d'un ou deux
minima (notamment entre 16 et 19 T.U), ce moyennage des écarts
à la gyroharmonique exacte ne joue plus et il apparaît une
erreur systématique (qui est ici une sous-estimation de la magnitude).
pour chaque spectre (par une moyenne harmonique de 1 à 8 points)
et on a tracé
cette valeur en fonction du temps (trait plein du bas), ainsi que ses
multiples entiers (autres traits pleins). Le résultat est très proche (1%)
de la magnitude fournie par le magnétomètre d'Ulysse (trait hachuré),
et même d'autant plus proche que le nombres de minima disponibles
est grand, ce qui montre que les écarts ne se font pas systématiquement
en amont ou en aval de l'harmonique considérée.
Par contre, lorsqu'on ne dispose que d'un ou deux
minima (notamment entre 16 et 19 T.U), ce moyennage des écarts
à la gyroharmonique exacte ne joue plus et il apparaît une
erreur systématique (qui est ici une sous-estimation de la magnitude).
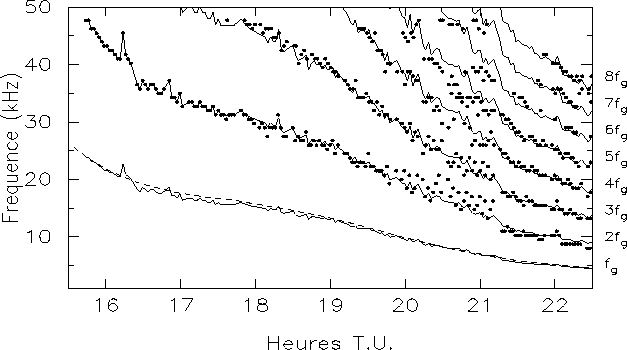
Figure iii.1: Fréquences mesurées aux minima des spectres (points)
avec en trait continu la gyrofréquence et ses harmoniques déduites de ces
minima. La gyrofréquence donnée par le magnétomètre à bord (moyennée sur 64s)
en indiquée à titre de comparaison (courbe hachurée).
Un Bilan
La figure ci-dessous résume toutes les mesures physiques qu'on a réussi à extraire des spectres radio collectés par Ulysse dans le tore de plasma d'Io et sa banlieue et uniquement dépendantes du milieu environnant la sonde. Cette figure rappelle (partie du haut) les spectrogrammes acquis par Ulysse entre 15 heures et 23 heures, sur le récepteur basses-fréquences entre 2 et 48 kHz, et sur le récepteur hautes-fréquences entre 50 et 400 kHz (sur une échelle logarithmique). La densité entre 15h et 17h15 a été déduite de la fréquence plasma ou hybride-haute (qui sont proches) soulignée sur le spectre dynamique HF et est représentée par des losanges noirs sur la figure du bas avec ses barres d'incertitude [Hoang et al., 1993]. La température des électrons a pu être ensuite déterminée pour cette même période par la méthode décrite dans la section ii.1 [Moncuquet, Meyer-Vernet and Hoang, 1995, ,] et est représentée par des + rouges. Entre 17h15 et 18h, les déterminations de la densité et de la température ne sont pas indépendantes et sont sujet à caution (d'où les barres d'incertitude importantes, voir ).
Entre 18h et 23h, seule la densité a pu être déterminée, à partir des
résonances ![]() des modes de Bernstein décalées Doppler
[Moncuquet et al., 1997, Chap II.2:,]. Ces
des modes de Bernstein décalées Doppler
[Moncuquet et al., 1997, Chap II.2:,]. Ces ![]() sont indiquées par des tirets
blancs sur le spectre dynamique basses-fréquences.
sont indiquées par des tirets
blancs sur le spectre dynamique basses-fréquences.
Enfin, la magnitude du champ magnétique, notée |B| sur la figure, est déterminée par la méthode des minima de bruit expliquée précédemment.
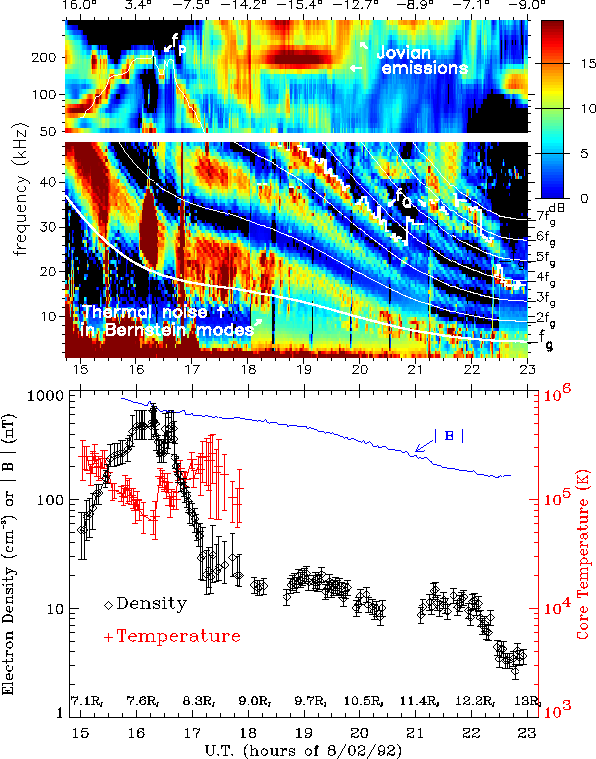
Figure iii.2:
Bilan des mesures d'Ulysse. Figure haute: rappel du spectre dynamique
mesuré par URAP sur Ulysse dans le tore de plasma d'Io et au delà
(voir pour
plus de détails la figure I.4). On a superposé la fréquence plasma ![]() lorsqu'elle est détectable, et les premières fréquences de résonance des
modes de Bernstein
lorsqu'elle est détectable, et les premières fréquences de résonance des
modes de Bernstein ![]() . Figure basse : Les principaux paramètres physiques
déduits de la spectroscopie du bruit quasi-thermique :
densité et température électronique, magnitude du champ en fonction du temps,
de la distance jovicentrique et de la latitude magnétique (en haut).
(à paraître dans Meyer-Vernet et al., [1997])
. Figure basse : Les principaux paramètres physiques
déduits de la spectroscopie du bruit quasi-thermique :
densité et température électronique, magnitude du champ en fonction du temps,
de la distance jovicentrique et de la latitude magnétique (en haut).
(à paraître dans Meyer-Vernet et al., [1997])