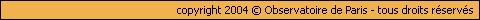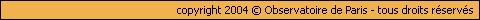Dans les années 60, alors que l'attention mondiale se focalisait sur l'exploration lunaire,
des sondes survolaient déjà Vénus et Mars et en rapportaient les premières images.
Le survol des planètes n'était qu'une première étape dans l'exploration planétaire et on a bientôt commencé à envoyer des modules d'atterrissage
vers des planètes à atmosphère épaisse. A présent, l'étape la plus difficile à réaliser techniquement est celle du retour d'échantillons.
Chacune de ces étapes prises isolément (survol, atterrissage puis retour d'échantillons), apportent des informations importantes mais incomplètes. Par contre, en les combinant,
on obtient tous les éléments essentiels à la compréhension du fonctionnement d'une planète.
L'exploration humaine sera peut-être une étape de la conquête spatiale,
elle obéit à des enjeux industriels et politiques qui dépassent le cadre des enjeux scientifiques.
Pour expliciter les enjeux scientifiques de l'exploration planétaire, il faut dégager deux thématiques principales.
La première est la planétologie comparée dont l'objectif est de rechercher des phénomènes pouvant expliquer les évolutions différentes
de deux planètes qui sembleraient avoir une origine similaire (cas des planètes telluriques).
La deuxième thématique émergente, et de plus en plus abordée par les nouvelles missions spatiales, est celle de la question des origines.
Par l'exploration spatiale actuelle, on tente d'apporter des éléments nouveaux à la réflexion sur les origines du système solaire, mais aussi,
et de manière plus générale, à celle sur l'origine de la vie.
Mais ces questions scientifiques ne peuvent recevoir de réponses sans l'appui indispensable des derniers développements technologiques. Ainsi,
la mise au point d'une mission prévoyant une analyse in situ et un retour d'échantillons nécessite l'élaboration d'un important programme de développement technologique en amont.
Aujourd'hui, l'exploration planétaire tend plutôt à l'élaboration de missions uniques ou en séries très limitées, ce qui génère un rique
industriel et un coût très élevés.
L'exploration planétaire est aujourd'hui axée sur trois approches : l'exploration des planètes telluriques, l'étude des planètes géantes
et l'étude des petits corps célestes du Système Solaire.
L'exploration des planètes telluriques est particulièrement centrée sur l'exploration de Mars, vers laquelle la plupart des programmes d'exploration
se tournent.
Ces missions tendent vers une étape future : le retour d'échantillons de Mars, qui pourrait être un préalable à d'éventuels vols habités.
L'Europe spatiale a déjà envoyé la sonde
Mars Express, opération qui pourrait se poursuivre par un vaste programme d'exploration du Système Solaire (Aurora),
alors que dans le même temps, la NASA poursuit son programme d'exploration martienne. Cependant, bien que la priorité soit mise sur Mars, d'autres planètes telluriques sont prévues à l'exploration. Vénus sera la destination de la mission
Venus Express de l'ESA
en 2006, et Mercure sera visitée par deux missions : Mercure Messenger (NASA) et
Bepi Colombo (ESA). Ces explorations seront précieuses pour faire avancer les recherches sur
la planétologie comparée.
Le deuxième axe de l'exploration planétaire actuelle est
l'étude des planètes géantes et de leurs satellites. Les missions lancées jusqu'à aujourd'hui vers les planètes géantes ont associées l'étude de la
planète à celle de ses satellites, et il en sera de même pour la mission
Cassini-Huygens lancée vers Saturne et son satellite, Titan.
En effet, pour des missions lointaines, coûteuses et espacées dans le temps, il faut privilégier la rentabilité de l'observation : une sonde doit pouvoir observer toutes les cibles auprès desquelles elle orbite.
Pour les missions vers Saturne et Jupiter, les objectifs scientifiques sont nombreux et primordiaux : déterminer la teneur en vapeur d'eau dans l'atmosphère profonde de Jupiter et Saturne, étudier leur météorologie, vérifier la
présence d'eau sous la voûte de glace d'Europe...
Enfin,
l'étude des petits corps tels que les astéroïdes, les comètes et les objets de Kuiper constitue le dernier axe de l'exploration spatiale. Ces objets, qui présentent des conditions environnementales très primitives
datant de l'origine du Système Solaire, peuvent nous apporter des éléments de réponse sur la question des origines de la vie.